Du promeneur, simple observateur de l’environnement naturel, au botaniste confirmé, qui n’a jamais croisé la carotte sauvage lors de ses pérégrinations ?
Cette plante se rencontre au bord des chemins, sur les lisières des cultures et celles des forêts si elles sont suffisamment ensoleillées.
Elle abonde parfois dans les prairies, notamment les années sèches, se développe aussi dans les friches et parvient jusqu’au cœur des villes à la faveur des délaissés.
Ce que vous allez apprendre
- Comment reconnaître la carotte sauvage
- Quels sont les types de carottes sauvages
- Quelles sont ses origines
Sode Yamaguchi
Qui se soucie de regarder la fleur de la carotte sauvage au temps des cerisiers ?
À quoi ressemble la carotte sauvage ?

La carotte sauvage (Daucus carota) se reconnaît facilement à ses fleurs blanches disposées en ombelles, souvent pourvues d’une fleur pourpre centrale.
À la base de l’ombelle, au pied des rayons, de petites feuilles transformées (les bractées) sont très découpées, ce qui est caractéristique.
Un autre trait typique est la fructification : l’ombelle se contracte en forme de nid en repliant ses rayons vers l’intérieur, ce qui enclot les fruits munis de crochets à l’intérieur.
La carotte sauvage ne produit qu’une racine fibreuse, non charnue : elle n’est pas alimentaire.
En fait, la carotte cultivée est originaire de la région de l’Afghanistan. Elle a développé une racine charnue et cassante, alimentaire, qui est parvenue en Europe au cours du temps et a été ensuite largement développée par l’agronomie en de multiples variétés (oranges, jaunes, violettes, blanches, rose foncé, etc.).
La consommation de carotte sauvage
Il faut bien distinguer deux expressions : « plante comestible » et « plante alimentaire ».
« Comestible » veut dire qui peut être mangé par l’homme, de par sa structure plus ou moins charnue et qui n’est ni insupportable au goût ni toxique. La qualité de « plante alimentaire » sous-entend un élément quantitatif : la plante peut être consommée par un grand nombre et pour cela être cultivée en quantité abondante. Les ouvrages énumérant les plantes alimentaires du monde en totalisent 350 à 400, alors que les plantes simplement comestibles sont plusieurs milliers.
La carotte sauvage est dans ce sens clairement une plante comestible mais non alimentaire. Dans le Régal végétal, Couplan (1983) donne des précisions : « la racine de la Carotte sauvage est parfois ligneuse à l’intérieur, avec pour seule partie comestible une mince couche extérieure charnue mais fibreuse […] On peut la hacher et la manger crue, ou bien la cuire et la passer à la moulinette ». Un tel effort n’est pas l’apanage du grand public qui préfère racines charnues et cassantes, pigmentées, rarement ramifiées, faciles à préparer.
Cela dit les usages culinaires de la Carotte sauvage sont multiples. Les racines jeunes et tendres ont un goût délicat et sucré. Elles peuvent aussi s’employer comme aromate dans les ragoûts et le pot-au-feu. Les feuilles se consomment crues ou cuites. Les fleurs se préparent en beignets et servent à fabriquer une liqueur nommée « huile de Vénus ». Les graines fraîches encore vertes écrasées au pilon avec du sucre aromatisent les desserts.
Une biologie particulière
La carotte sauvage fait preuve d’une biologie bien particulière. Elle est bisannuelle, plus rarement annuelle lorsque la rosette de feuille plaquée au sol monte à fleur dès la première année.
Chaque plante disparaît après la dissémination de ses fruits.
L’ombelle forme un plateau attirant de nombreux insectes, par le disque blanc visible à distance, l’odeur miellée des fleurs et la fleur pourpre centrale qui simule un insecte posé au centre.
A la fin du cycle, l’ombelle recourbée en nid s’ouvre et se referme en fonction de l’humidité atmosphérique. Ainsi, les fruits sont libérés progressivement au cours de l’arrière-saison, cet échelonnement augmentant les chances d’un environnement récepteur favorable.
Le fruit se dissémine sur les animaux par ses aiguillons crochus, on parle « d’épizoochorie ».
Mais l’impact dans les écosystèmes ne s’arrête pas là.
La carotte sauvage renferme dans ses différents organes un véritable arsenal chimique constitué de molécules actives susceptibles de diffuser dans l’environnement. Près de 80 constituants volatils appartenant à des familles chimiques distinctes ont été mis en évidence.
Deux types de carotte sauvage

La plupart des peuplements de carottes sauvages se situent à l’intérieur des terres.
Sur les littoraux, on rencontre en revanche un autre type de carotte sauvage : les carottes à gommes présentes sur toutes les côtes atlantiques et méditerranéennes (Corse incluse).
Elles possèdent des feuilles luisantes, vernissées, épaisses et renferment une gomme-résine (qui perle si l’on entaille la tige sous l’ombelle). On peut considérer ces traits comme une adaptation aux milieux chargés en embruns salés.
Ce sont des plantes généralement trapues, aux ombelles en forme de plateau ou de dôme, ne formant pas le nid à maturité (ou seulement les plus tardives).
Elles poussent sur les rochers et les pelouses des bords de mer.
Aux origines de la carotte sauvage

Cette dualité entre les deux types de carottes sauvages peut trouver son explication dans leur origine différente.
Les carottes littorales occupent des biotopes primaires (parfois très transformés par l’urbanisation littorale) sur un linéaire côtier.
Des études génétiques ont montré que les méditerranéennes étaient demeurées très diversifiées, formant un chapelet de peuplements distincts adaptés aux différents biotopes de la côte (notamment variation du substrat).
Sur la façade atlantique, au contraire, seulement deux unités sont présentes, dans le Pays basque et toute la succession littorale depuis le sud de la Bretagne jusqu’au nord de la France. Ceci s’explique par l’influence des glaciations ayant gommé la diversité précédente, préglaciaire (qui est encore présente au long des côtes méditerranéennes).
Quant aux carottes de l’intérieur, leur présence peut s’expliquer par une origine ancienne, extérieure : on ne les rencontre que dans des milieux secondaires, plus ou moins fortement influencés par l’homme.
Il est même possible d’estimer très probable une origine du Moyen-Orient. La conformation de l’ombelle en nid libérant ses semences peu à peu est un caractère steppique à saisons très contrastées et le développement de fleurs sombres au centre de l’ombelle se rencontre chez plusieurs espèces différentes de ces régions.
La carotte sauvage de l’intérieur serait donc parvenue en Europe par ses différents usages, la fourrure des troupeaux ou animaux de trait, des migrations animales naturelles, par exemple, ou bien une combinaison de ces facteurs.
Carottes géantes : nous rendent-elles dix fois plus aimables ?

Parmi les carottes de friches, on rencontre parfois des individus géants, atteignant deux mètres !
Il s’agit de la sous-espèce Daucus carota maximus, de floraison précoce et essentiellement présente sous climat méditerranéen.
En Corse, ses ombelles ont jusqu’à 25 centimètres de diamètre, et même 40 centimètres au Maroc.
Dans le paysage, elles ressemblent à des assiettes florales et sont très visitées. Ce sont de véritables « insectodromes » !
Un intérêt agronomique accru

Les carottes sauvages captivent particulièrement les agronomes !
Il faut dire que la carotte cultivée connaît un regain d’intérêt du fait de ses propriétés (provitamine A, antioxydants, etc.) et de l’élargissement des modes de consommation (saveurs des différents cultivars, variétés anciennes, jus, etc.) lié à un fort accroissement mondial de sa culture.
Les agronomes recherchent des gènes de résistance aux pathogènes, de nouvelles saveurs, des propriétés de conservation améliorée et bien plus encore !
Il est nécessaire de puiser dans la très riche diversité des peuplements, dont l’inventaire puis la conservation professionnelle sont pratiqués, associés à la caractérisation génétique.
Si la carotte sauvage ne pose pas globalement de problèmes de régression, il n’en est pas de même pour certains peuplements particuliers de front de mer, en termes de morphologie, d’écologie et de constitution chimique. Des menaces actives ou potentielles de disparition pèsent sur ceux-ci, principalement en raison d’un aménagement agressif du littoral.
C’est par exemple le cas de la carotte de Gadeceau (sous-espèce Daucus carota gadecaei), limitée à la Bretagne et au Pays basque, plante naine de gazons maritimes naturels très ras qui est protégée au niveau national.
Driss Chraibi
Le bonjour amène la conversation et la conversation amène la carotte.
Des potentiels
La carotte sauvage, répartie en types de l’intérieur des terres et types littoraux (très diversifiés), révèle de fortes potentialités et s’associe à des enjeux multiples :
- Elle est précieuse en agroécologie, favorisant l’entomofaune tout en développant facilement de larges peuplements.
- Elle renferme un arsenal de substances naturelles actives, utilisables aux plans de la santé et de l’alimentation humaine tout comme en protection de l’environnement.
- Elle constitue un réservoir d’études scientifiques (biologie, génétique, phytochimie, applications).
- On peut parler de complexe spécifique, ce qui incite à faire évoluer les modes de classification et de nomenclature pour une meilleure compréhension.
Pour conclure
A l’issue de ce texte, peut-être que le lecteur pourra regarder d’un œil nouveau le ballet incessant des insectes visiteurs des ombelles blanches, les curieux nids de fruits épineux qui couronnent ces plantes au bord de son chemin.
Peut-on alors espérer un cheminement spirituel au contact de ces plantes, en majorité communes, vers les potentiels qui nous entourent dans la nature végétale, dite ordinaire ?
Au-delà, la famille de la carotte, les Apiacées, riche de 4 000 espèces environ, profile une importance particulièrement élevée pour l’homme et l’environnement. Elle mérite une attention spéciale, à propos de l’amélioration de sa connaissance, la recherche de nouveaux usages et l’efficacité de sa conservation.
Et vous, sous quel angle observez-vous la carotte sauvage ?
CommenterGarantissez la qualité de vos actions de gestion de la biodiversité
Faune et Flore
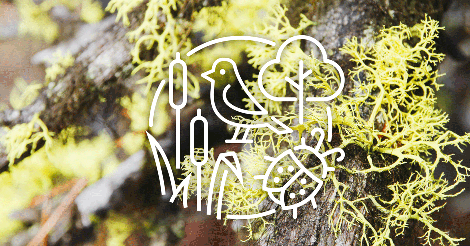
Mise en place stricte de protocoles d’études
Créativité et inventivité de nos différents processus de réflexion
Déontologie appliquée à l’intégralité de nos démarches
Partage des risques à travers l’application de nouvelles techniques
Les spécialistes du sujet sont sur vos réseaux sociaux préférés

Agrocampus Ouest

Tela Botanica

Maxisciences
Jean-Pierre Reduron
Botaniste
Spécialiste de la famille des Apiacées, il participe à plusieurs collaborations nationales et internationales.
Auteur de nombreux articles, il a surtout produit l’ouvrage encyclopédique « Ombellifères de France », fruit de 24 années de travaux pluridisciplinaires. Il s’est continuellement impliqué dans la conservation du monde végétal.
Après 40 années de spécialisation, il cherche à améliorer la connaissance, l’usage, la classification et la conservation des Apiacées qui compte désormais près de 4000 espèces, recensées à travers son entreprise VIA APIA.




Jolie a regarder ,utile pour les insectes notamment plante hôte pour la chenille du Machaon .
A croire que vous vous y connaissez un peu en carotte sauvage, je me trompe ? 🙂
In my work of Applied Zoopharmacognosy, animal self medication, animals have been observed selecting wild carrot seed essential oil for internal bleeding, liver disorders, cell regeneration and tumours.
Bonjour. A t’elle un intérêt nutritionnel pour les animaux (bovins) ? Merci
« Le balai incessant des insectes visiteur »… (en conclusion). Certains insectes ont des brosses, mais pas de balai. Ne serait-ce pas plutôt le ballet ?
Bonjour et merci… On a beau faire, même avec une armée de relecteurs extérieur il y a toujours quelque chose qui passe 🙂
Disons que c’est toujours préférable à ce que le fond de l’article soit mauvais, non ?
Merci encore en tout cas.
Pour ce qui est du fond, je connais bien Jean-Pierre Reduron. Pas de problème de ce côté-là.
Ah les chipoteurs sur l’orthographe…j’avoue, même réflexion de ma part…si vous avez besoin d’un œil nouveau pour traquer les petits bugs, je me propose…et en soi bel article sur la carotte sauvage, merci !
Ils sont importants ces petits chipoteurs, je dirais même essentiels 🙂 Un contenu est aussi valorisé par sa mise en forme et cela comprend la langue française !
Mais, même avec des relecteurs extérieurs (systématique pour chacun de nos articles) la coquille arrive. Ce que je trouve remarquable, c’est que nos lecteurs sont à la fois assez avertis pour les remarquer et assez bienveillants pour nous les signaler…
Au plaisir de vous lire,
PS: je garde votre adresse au cas où nous manquerions d’yeux pour les relectures.
Avec grand plaisir Julien !
Bonjour, je suis très intéressée par cet article sur cette fleur que j’ai découverte l’an passé. Je suis étonnée d’entendre parler du type à « gomme » qu’on trouverait sur les côtes y compris en Corse. Or, c’est en Corse que je les observe, aussi bien en bord de mer que plus dans les terres, mais jamais très loin de la mer. Cependant, je n’ai jamais observé de ces carottes qui ne se referment pas lorsqu’elles sont montées à graine. Est-ce normal ?
Bien sûr qu’elle est comestible ! Peut-être pas à tous les goûts mais elle a séduit le mien. C’est que les plantes sauvages sont des durs à cuir et qu’il faut beaucoup de doigter et d’amour à leur égard pour percer leur délices.
Bonjour, Est-ce que la fleur ou la tige de la carotte sauvage peut être consommée en infusion ? Merci pour votre réponse
Bonjour à vous,
Pour ce qui concerne la consommation de la carotte sauvage vous trouverez un nouveau paragraphe dans le texte qui résume bien les choses sur le sujet !
A tous ceux qui se posent ou posaient la question de la consommation de la carotte sauvage, l’auteur vient d’augmenter l’article de précisions en la matière !
Bonne (re)-lecture à tous 🙂
Ah quand même : les fruits de carotte sauvage à maturité dégagent un arôme de poire, voire de williamine, absolument délicieux, ce qui les rend propres à aromatiser desserts et boissons. Franchement, j’aime !
Mais attention : trop jeunes, ils sentent la térébenthine, trop vieux, ils ne valent plus rien.
Essayez !
Et merci pour ce bel article.
J’avais remarqué l’odeur de carotte des racines blanches de cette plante, et j’allais presque y goûter, quand j’ai pensé à la ciguë. Du coup, comme je ne sais pas les reconnaître, je me suis abstenu…
zoochore… on peut signaler que l’espèce humaine participe à la dissémination, notamment pour les nombreux individus de Daucus carota présents dans les vignes en culture biologique parcourues par les vendangeurs en récoltant abondamment des graines sur leurs vêtements…
j’ai un tendre et délicat souvenir du temps ou j’accompagnai mon grand père en fin d’été , quand il ramassait ses regains, une odeur douce et mielleuse parfumait ces moments et j’aime parler et monter à ma petite fille cette plante qu’elle nome à 7 ans daucus en faisant tourner l’ombelle sous son nez, pour mieux en apprécier la sensibilité.
bonne pioche
J’étais contente de lire qu’elle est bisannuelle, car cette année (effectivement année sèche) elle a totalement envahi notre verger communale. (dans la plaine du Grésivaudan, à l’est de Grenoble)
Nous essayons de laisser la prairie entre les arbres, mais nous sommes obligé de couper sous les arbres pour surveille/ramasser les pommes qui tombent, et cet « fichu » carotte sauvage a une tige trop forte pour le roto-fil, nous obligeant à changer pour les lames débroussailleuse. Alors que l’année dernière elle était très peu présent.
Merci pour l’article 🙂
En Bretagne, par deux fois dans un grand jardin, constatation par le médecin, de brulures étonnantes dûes à une carotte sauvage poussant essentiellement en montagne. Pas grave sauf près de l’oeil, mais une crème à la cortisone
en trois jour la croute tombe et c’est fini.
Joli fleur trop méconnue et qui attire aussi les mantes religieuse dans mon jardin
Installé près d’un arbre, dans une prairie en butte, je découvre les carottes sauvages (du moins leur noms) et votre article qui m’ait très utile. Merci.
La journée se termine, le soleil va disparaitre. La vue est belle sur ce champ de carottes sauvages. Une brise de vent animé le tout.
Installé près d’un arbre, dans une prairie en butte, je découvre les carottes sauvages (du moins leur nom) et votre article qui m’ait très utile. Merci.
La journée se termine, le soleil va disparaitre. La vue est belle sur ce champ de carottes sauvages. Une brise de vent animé le tout.